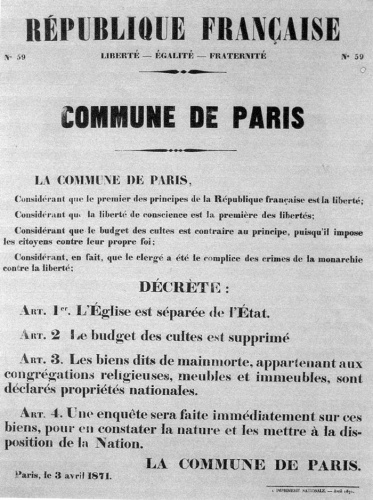Pierre Kropotkine
" La Grande Révolution "
XI
PARIS À LA VEILLE DU 14 JUILLET
" C'est ainsi que de la part des meneurs adroits de la bourgeoisie, commençait le système de trahisons que nous verrons se produire durant toute la Révolution. "
Généralement, l'attention des historiens est absorbée par l'Assemblée nationale. Les représentants du peuple, réunis à Versailles, semblent personnifier la Révolution, et leurs moindres paroles, leurs gestes sont recueillis avec une pieuse dévotion. Cependant, ce n'est pas là qu'étaient, pendant ces journées de juillet, le cœur et le sentiment de la Révolution. Ils étaient à Paris.
Sans Paris, sans son peuple, l'Assemblée n'était rien. Si la peur de Paris en révolte n'avait pas retenu la Cour, celle-ci aurait certainement dispersé l'Assemblée, comme cela s'est vu tant de fois depuis : au 18 brumaire et au 2 décembre en France, et tout récemment encore en Hongrie, en Russie. Sans doute, les députés auraient protesté ; sans doute, ils auraient prononcé quelques belles paroles, et quelques-uns d'entre eux auraient peut-être tenté de soulever les provinces... Mais, sans le peuple, prêt à se soulever, sans un travail révolutionnaire accompli dans les masses, sans un appel au peuple pour la révolte, fait directement d'homme à homme et non pas par des manifestes, – une assemblée de représentants reste fort peu de chose vis-à-vis d'un gouvernement établi, avec son réseau de fonctionnaires, son armée.
Heureusement, Paris veillait. Pendant que l'Assemblée s'endormait dans une sécurité imaginaire et reprenait tranquillement, le 10 juillet, la discussion du projet de Constitution, le peuple de Paris, auquel les plus audacieux et les plus perspicaces de la bourgeoisie avaient enfin fait appel, se préparait à l'insurrection. On se répétait dans les faubourgs les détails du coup de filet militaire que la Cour était en train de préparer pour le 16 ; on savait tout – jusqu'à la menace du roi de se retirer à Soissons et de livrer Paris à l'armée, – et la grande fournaise s'organisait dans ses districts pour mieux répondre à la force par la force. Les «auxiliaires séditieux», dont Mirabeau avait menacé la Cour, avaient été appelés en effet, et dans les sombres cabarets de la banlieue, le Paris pauvre, en guenilles, discutait les moyens de «sauver la patrie». Il s'armait comme il pouvait.
Des centaines d'agitateurs patriotes, – des «inconnus», bien entendu, – faisaient tout pour maintenir l'agitation et attirer le peuple dans la rue. Les pétards et les feux d'artifice, dit Arthur Young, étaient un des moyens en vogue ; on les vendait à moitié prix, et quand une foule se rassemblait pour voir tirer un feu d'artifice au coin d'un carrefour, quelqu'un commençait à haranguer le peuple et lui racontait les nouvelles des complots de la Cour. Pour dissiper ces rassemblements, «jadis il eût suffi d'une compagnie de suisses ; aujourd'hui il faudrait un régiment ; dans quinze jours il faudra une armée», disait Arthur Young aux approches du 14 juillet (p. 219).
En effet, dès la fin de juin, le peuple de Paris était en pleine ébullition et se préparait à l'insurrection. Déjà au commencement de juin on s'attendait à des émeutes, à cause de la cherté des blés, dit le libraire anglais Hardy, et si Paris resta calme jusqu'au 25 juin, c'est que, jusqu'à la séance royale, il espérait toujours que l'Assemblée ferait quelque chose. Mais, le 25, Paris comprenait qu'il ne restait d'autre espoir que l'insurrection.
Un attroupement de Parisiens se portait sur Versailles, prêt à engager un conflit avec les troupes. À Paris même, il se formait partout des attroupements « disposés à se porter aux plus horribles extrémités », lit-on dans les Notes secrètes adressées au ministre des affaires étrangères, publiées par Chassin (Les Élections et les cahiers de Paris, Paris, 1889, t. III, p. 453). «Le peuple a été en mouvement toute la nuit, il a fait des feux de joie et il a tiré un nombre prodigieux de fusées devant le Palais Royal et le Contrôle Général.» On criait : «Vive M. le duc d'Orléans !»
Ce même jour, le 25, les soldats des gardes-françaises désertaient leurs casernes, fraternisaient en buvant avec le peuple qui les attirait dans divers quartiers et parcouraient les rues en criant : À bas la calotte !
Entre temps, les «districts» de Paris, c'est-à-dire les assemblées primaires des électeurs, surtout celles des quartiers ouvriers, se constituaient régulièrement et prenaient leurs mesures pour organiser la résistance à Paris. Les «districts» se tenaient en relations suivies entre eux, et leurs représentants faisaient des efforts suivis pour se constituer en un corps municipal indépendant. Le 25, à l'assemblée des électeurs, Bonneville lançait déjà l'appel aux armes et faisait aux électeurs la proposition de se constituer en «Commune», en se fondant sur l'histoire pour motiver sa proposition. Le lendemain, après s'être réunis d'abord au musée de la rue Dauphine, les représentants des districts se transportaient enfin à l'Hôtel de Ville. Le 1er juillet, ils tenaient déjà leur deuxième séance, dont le procès-verbal est donné par Chassin, t. III, p. 439-444, 458, 460. Ils constituaient ainsi le «Comité permanent» qui siégea pendant la journée du 14 juillet.
Le 30 juin, un simple incident – l'arrestation de onze soldats des gardes-françaises qui avaient été envoyés en prison à l'Abbaye, pour avoir refusé de charger leurs fusils à balles – suffisait pour produire une émeute dans Paris. Lorsque Loustalot, rédacteur des Révolutions de Paris, monta au Palais-Royal sur une chaise en face du café Foy et harangua la foule à ce sujet, quatre mille hommes se portèrent de suite à l'Abbaye et mirent les soldats arrêtés en liberté. Les geôliers, lorsqu'ils virent arriver cette foule, comprirent que la résistance serait inutile, et ils remirent leurs prisonniers au peuple ; et lorsque les dragons accoururent à bride abattue, prêts à fondre sur le peuple, ils hésitèrent, remirent leurs sabres dans les fourreaux et fraternisèrent avec la foule, – incident qui fit frémir l'Assemblée lorsqu'elle apprit le lendemain que la troupe avait pactisé avec l'émeute. «Allons-nous devenir les tribuns d'un peuple effréné ?» se demandaient ces messieurs.
Mais l'émeute grondait déjà dans la banlieue de Paris. À Nangis, le peuple avait refusé de payer les impôts tant qu'ils n'auraient pas été déterminés par l'Assemblée ; et, comme le pain manquait (on ne vendait pas plus de deux boisseaux de froment à chaque acheteur), le marché était entouré de dragons. Cependant, malgré la présence de la troupe, il y eut plusieurs émeutes, à Nangis et dans d'autres petites villes de la banlieue. Une querelle entre le peuple et les boulangers surgissait facilement, et alors on enlevait tout le pain sans payer, dit Young (p. 225). Le 27 juin, le Mercure de France parle même de tentatives faites en divers endroits, notamment à Saint-Quentin, de faucher les récoltes en vert, si grande était la disette.
À Paris, les patriotes allaient déjà le 30 juin s'inscrire au café du Caveau, pour l'insurrection ; et le lendemain, lorsqu'on apprit que Broglie avait pris le commandement de l'armée, la population, disent les rapports secrets, disait et affichait partout que «si la troupe tirait un seul coup de fusil, on mettrait tout à feu et à sang... Elle a dit beaucoup d'autres choses, beaucoup plus fortes... Les gens sages n'osent plus paraître», ajoute l'agent.
Le 2 juillet, les fureurs de la population éclatent contre le duc d'Artois et les Polignac. On parle de les tuer, de saccager leurs palais. On parle aussi de s'emparer de tous les canons répartis dans Paris. Les attroupements sont plus nombreux et «la fureur du peuple est inconcevable», disent les mêmes rapports. Ce même jour, dit le libraire Hardy dans son journal, il s'en est fallu de bien peu qu'il partît, «vers les huit heures du soir, une multitude de furieux, du jardin du Palais-Royal», pour dégager les députés du Tiers que l'on disait exposés à être assassinés par les nobles. Dès ce jour, on parlait d'enlever les armes aux Invalides.
La fureur contre la Cour marchait de pair avec les fureurs inspirées par la disette. En effet, le 4 et le 6, on prévoyait le pillage des boulangeries ; des patrouilles de gardes-françaises circulaient dans les rues, dit Hardy, et elles surveillaient la distribution du pain.
Le 8 juillet, un prélude de l'insurrection éclatait à Paris même, dans le camp de vingt mille ouvriers sans travail que le gouvernement occupait à faire des terrassements à Montmartre. Deux jours après, le 10, le sang coulait déjà, et ce même jour les barrières commençaient à flamber. Celle de la Chaussée-d'Antin était incendiée, et le peuple en profitait pour faire entrer des provisions et du vin sans payer d'octroi.
Est-ce que Camille Desmoulins aurait jamais fait, le 12, son appel aux armes s'il n'eût pas été sûr qu'il serait entendu – s'il n'eût pas su que Paris se soulevait déjà ? que douze jours auparavant Loustalot avait soulevé la foule sur un fait de moindre importance, et que maintenant le Paris des faubourgs n'attendait plus que le signal, l'initiative, pour s'insurger ?
La fougue des princes, sûrs du succès, avait précipité le coup d'État, préparé pour le 16, et le roi fut forcé d'agir avant que les renforts de troupes fussent arrivés à Versailles [1].
Necker fut renvoyé le 11, – le duc d'Artois lui mettant le poing sous le nez au moment où le ministre se rendait à la salle du Conseil des ministres, et le roi, avec sa fourberie ordinaire, feignait ne rien savoir, alors que le renvoi était déjà signé. Necker se soumit, sans mot dire, aux ordres de son maître. Il entra même dans ses plans et sut arranger son départ pour Bruxelles de façon à ne pas soulever le moindre bruit à Versailles.
Paris ne l'apprit que le lendemain, dimanche, le 12, vers midi. On s'attendait déjà à ce renvoi : il devait être le commencement du coup d'État. On se répétait déjà la parole du duc de Broglie qui, avec ses trente mille soldats, massés entre Paris et Versailles, «répondait de Paris», et comme des rumeurs sinistres circulaient dès le matin, concernant les massacres préparés par la Cour, le «tout Paris révolutionnaire» se porta en masse au Palais-Royal. C'est là qu'arriva le courrier apportant la nouvelle de l'exil de Necker. La Cour s'était donc décidée à ouvrir les hostilités... Et alors Camille Desmoulins, sortant d'un des cafés du Palais-Royal, le café Foy, avec une épée dans une main et un pistolet dans l'autre, monta sur une chaise et lança son appel aux armes. Cassant une branche d'arbre, il prit, comme on sait, une feuille verte pour cocarde et signe de ralliement. Et son cri : Il n'y a pas un moment à perdre : courez aux armes ! se répandit dans les faubourgs.
Dans l'après-midi, une immense procession, portant les bustes du duc d'Orléans et de Necker, voilés de crêpe (on disait que le duc d'Orléans était aussi exilé), traverse le Palais-Royal, longe la rue Richelieu et se dirige vers la place Louis XV (aujourd'hui Place de la Concorde), occupée par la troupe : des Suisses, de l'infanterie française, des hussards et des dragons, sous les ordres du marquis de Besenval. Les troupes se voient bientôt enveloppées par le peuple ; elles essaient de le repousser à coups de sabre, elles tirent même ; mais devant la foule sans nombre qui les pousse, les bouscule, les presse et les enveloppe en rompant leurs rangs, elles sont forcées de se retirer. D'autre part, on apprend que les gardes-françaises ont tiré quelques coups de fusil sur «le Royal-Allemand» – régiment fidèle au roi, – et que les Suisses refusent de tirer sur le peuple. Alors Besenval qui, paraît-il, n'avait pas grande confiance dans la Cour, se retire devant le flot montant du peuple et va camper au Champ de Mars [2].
La lutte s'est ainsi engagée. Mais quelle en sera l'issue finale, si la troupe, restée fidèle au roi, reçoit l'ordre de marcher sur Paris ? Alors, les révolutionnaires bourgeois se décident à accepter – avec répugnance – le moyen suprême, l'appel au peuple. Le tocsin sonne dans tout Paris, et les faubourgs se mettent à forger les piques [3]. Peu à peu, ils commencent à descendre, armés, dans la rue. Toute la nuit des hommes du peuple forcent les passants à leur donner de l'argent pour acheter de la poudre. Les barrières flambent. Toutes les barrières de la rive droite, depuis le faubourg Saint-Antoine jusqu'à celui de Saint-Honoré, ainsi que celles de Saint-Marcel et de Saint-Jacques, sont incendiées : les provisions et le vin entrent librement dans Paris. Toute la nuit le tocsin sonne, et la bourgeoisie tremble pour ses propriétés, car des hommes armés de piques et de bâtons se répandent dans tous les quartiers et pillent les maisons de quelques ennemis du peuple, des accapareurs, et frappent aux portes des riches en leur demandant du pain et des armes.
Le lendemain, le 13, le peuple se porte, avant tout, là où il y a du pain, notamment au monastère Saint-Lazare qui est assailli aux cris : Du pain, du pain ! Cinquante-deux charrettes sont chargées de farines et non pas pillées, sur place, mais traînées aux Halles, afin que le pain serve pour tout le monde. C'est aussi aux Halles que le peuple dirige les provisions entrées dans Paris sans payer l'octroi [4].
En même temps, le peuple s’emparait de la prison de la Force, où l'on détenait alors pour dettes, et les détenus, mis en liberté traversèrent Paris en remerciant le peuple ; mais une émeute des prisonniers du Châtelet fut apaisée, apparemment par les bourgeois, qui s'armaient en toute hâte et lançaient leurs patrouilles dans les rues. Vers six heures les milices bourgeoises, déjà formées, se portaient, en effet, vers l'Hôtel-de-Ville, et à dix heures du soir, dit Chassin, elles entraient en service.
Taine et consorts, échos fidèles des peurs de la bourgeoisie, cherchent à faire croire que le 13, Paris «fut aux mains des brigands». Mais cette allégation est contredite par tous les témoignages de l'époque. Il y eut, sans doute, des passants arrêtés par des hommes à piques qui leur demandaient de l'argent pour s'armer, et il y eut aussi, dans la nuit du 12 au 13, et du 13 au 14, des hommes armés qui frappaient aux portes des riches pour leur demander à manger et à boire, ou bien des armes et de l'argent. Il est avéré aussi qu'il y eut des tentatives de pillage, puisque des témoins dignes de foi parlent de gens exécutés dans la nuit du 13 au 14 pour tentatives de ce genre [5]. Mais ici, comme ailleurs, Taine exagère.
N'en déplaise aux républicains bourgeois modernes, les révolutionnaires de 1789 firent appel aux «auxiliaires compromettants» dont parlait Mirabeau. Ils allèrent les chercher dans les taudis de la banlieue. Et ils eurent parfaitement raison, parce que s'il y eut quelques cas de pillage, ces auxiliaires, comprenant la gravité de la situation, mirent leurs armes au service de la cause générale, bien plus qu'ils ne s'en servirent pour assouvir leurs haines personnelles ou pour alléger leur misère.
Il est aussi certain que les cas de pillage furent très rares. Au contraire, l'esprit des foules armées devint très sérieux lorsqu'elles apprirent l'engagement qui avait eu lieu entre les troupes et les bourgeois. Les hommes à piques se considéraient évidemment comme des défenseurs de la ville, sur lesquels pesait une lourde responsabilité. Marmontel, ennemi avéré de la Révolution, relève néanmoins ce trait intéressant : – «Les brigands eux-mêmes, saisis de la terreur (?) commune, ne commirent aucun dégât. Les boutiques des armuriers furent les seules qu'on fit ouvrir et on n'y prit que des armes», dit-il dans ses Mémoires. Et lorsque le peuple amena, place de la Grève, la voiture du prince de Lambesc, pour la brûler, il remit la malle et tous les effets trouvés dans la voiture à l'Hôtel-de-Ville. Chez les Lazaristes, le peuple refusa l'argent et ne prit que les farines, les armes et le vin, qui furent transportés place de la Grève. Rien ne fut touché ce jour-là, ni au Trésor, ni à la Caisse d'Escompte, remarque l'ambassadeur anglais dans sa relation.
Ce qui est vrai, c'est que la peur de la bourgeoisie, à la vue de ces hommes et femmes en loques, affamés, armés de gourdins et de piques «de toutes façons», la terreur inspirée par ces spectres de la faim descendus dans les rues fut telle que jamais la bourgeoisie n'en put revenir. Plus tard, en 1791 et 1792, ceux-là mêmes des bourgeois qui voulaient en finir avec la royauté, préféraient la réaction, plutôt que de faire une nouvel appel à la révolution populaire. Le souvenir du peuple affamé et armé, qu'ils avaient entrevu les 12, 13 et 14 juillet 1789, les hantait.
«Des armes», tel était le cri du peuple après qu'il eut trouvé un peu de pain. On en cherchait partout, sans en trouver, pendant que nuit et jour on forgeait dans les faubourgs des piques de tous les dessins possibles, avec le fer que l'on trouvait sous la main.
La bourgeoisie, entretemps, sans perdre un moment, constituait son autorité : sa municipalité, à l'Hôtel de Ville, et sa milice.
On sait que les élections à l'Assemblée Nationale avait lieu à deux degrés ; mais les élections faites, les électeurs du Tiers, auxquels se joignirent quelques électeurs du clergé et de la noblesse, avaient continué à se réunir à l'Hôtel-de-Ville – à partir du 27 juin, avec l'autorisation du Bureau de la Ville et du ministre de Paris. Eh bien, ces électeurs prirent l'initiative d'organiser la milice bourgeoise. Le 1er juillet, nous les avons déjà vus tenir leur première séance.
Le 12 juillet, ils instituèrent un Comité permanent, présidé par le prévôt des marchands, Flesselles, et ils décidèrent que chacun des soixante districts choisirait deux cents citoyens connus et en état de porter les armes, qui formeraient un corps de milice de 12.000 hommes, pour veiller à la sûreté publique. Cette milice devait être portée, en quatre jours, au chiffre total de 48.000 hommes, pendant que le même Comité cherchait à désarmer le peuple.
« Ainsi, dit très bien Louis Blanc, la bourgeoisie se donnait une garde prétorienne de 12.000 hommes. Au risque de subir la Cour, on voulait désarmer le peuple. »
Au lieu du vert des premiers jours, cette milice devait porter maintenant la cocarde rouge et bleue, et le Comité permanent prit des mesures pour que le peuple, en s'armant, n'envahît pas les rangs de cette milice. Il ordonna que quiconque porterait des armes et la cocarde rouge et bleue, sans avoir été enregistré dans un des districts, serait remis à la justice du Comité. Le commandant général de cette garde nationale avait été nommé par le Comité permanent dans la nuit du 13 au 14 juillet : ce fut un noble, le duc d'Aumont. Il n'accepta pas, et alors, à son défaut, un autre noble, le marquis de la Salle, nommé commandant en second, prit le commandement.
Bref, pendant que le peuple forgeait les piques et s'armait, pendant qu'il prenait des mesures pour que l'on ne fît pas sortir la poudre de Paris, pendant qu'il s'emparait des farines et les faisait porter aux Halles, ou place de la Grève, pendant qu'il construisait, le 14, les barricades pour empêcher la troupe d'entrer dans Paris, s'emparait des armes aux Invalides, et se portait en masse vers la Bastille, pour la forcer de capituler, la bourgeoisie veillait à ce que le pouvoir n'échappât pas de ses mains. Elle constituait la Commune bourgeoise de Paris, qui chercha à enrayer le mouvement populaire, et à la tête de cette Commune elle plaçait Flesselles, le prévôt des marchands, qui correspondait avec la Polignac, pour entraver le soulèvement de Paris. On sait que le 13, lorsque le peuple vint lui demander des armes, il se fit envoyer des caisses contenant du vieux linge, au lieu de fusils, et le lendemain, il usa de toute son influence pour empêcher le peuple de prendre la Bastille.
C'est ainsi que de la part des meneurs adroits de la bourgeoisie, commençait le système de trahisons que nous verrons se produire durant toute la Révolution.
- Voyez les lettres de l'envoyé saxon Salmour, à Stutterheim, du 19 juillet et du 20 août. Archives de Dresde, citées par Flammermont, la Journée du 14 juillet 1789, par Pitra. Publication de la Société de l'Histoire de la Révolution Française, 1892.
- «Les gardes-françaises, s'étant joint à la populace, ont tiré sur un détachement du régiment Royal-Allemand, posté sur le boulevard, sous mes fenêtres. Il y a eu deux hommes et deux chevaux de tués», écrit Simolin, ministre plénipotentiaire de Catherine II à Paris, au chancelier Osterman, le 13 juillet. Et il ajoutait : «Avant-hier et hier soir on a brûlé la barrière Blanche et celle du faubourg Poissonnière.» (Couches, Lettres de Louis XVI, etc., p. 223).
- Elles furent fabriquées au nombre de 50.000, ainsi que «toutes sortes d'armes subalternes», aux dépens de la Ville, dit Dusaulx (L'Œuvre de sept jours, p. 203).
- «On amenoit de toutes parts à l’Hôtel de Ville un nombre infini de voitures, de chariots, de charrettes, arrêtés aux portes de la ville et chargés de toutes sortes de provisions, de vaisselle, de meubles, de subsistances, etc. Le peuple qui ne soupiroit qu'après des armes et des munitions... nous arrivoit en foule et devenoit plus pressant de minute en minute.» C'était le 13 juillet (Dusaulx, L'Œuvre de sept jours, dans Mémoires sur la Bastille, Linguet-Dusaulx, publiées par H. Monin, Paris, 1889, p. 197).
- Les citations que M. Jules Flammermont donne en note dans son ouvrage sur le 14 juillet (La journée du 14 juillet 1789, fragment des Mémoires de L.-G. Pitra, avec introduction et notes, Paris, 1892) sont décisives à ce sujet, – plus décisives que son texte, qui nous semble jusqu'à un certain point se contredire aux page CLXXXI et CLXXXII. «Dans l'après-midi, dit le comte de Salmour, la garde bourgeoise déjà formée commença à désarmer tous les gens sans aveu. C'est leur vigilance et celle des bourgeois armés qui sauva encore Paris cette nuit... La nuit se passa tranquillement et avec beaucoup d'ordre ; on arrêtait les voleurs et gens sans aveu et, pour les cas plus graves, on pendait sur le champ.» (Lettre du comte de Salmour du 16 juillet 1789, Archives de Dresde). Le passage suivant d'une lettre du docteur Rigby, que M. Flammermont donne en note, p. CLXXXIII, et que je traduis textuellement de l'anglais, dit la même chose : «Lorsque la nuit arriva, très peu de gens qui s'étaient armés la veille au soir, étaient visibles. Quelques-uns, cependant, avaient refusé de rendre leurs armes et ils prouvèrent dans le courant de la nuit, combien justes étaient les appréhensions des habitants à leur égard, puisqu'ils se mirent à piller ; mais c'était trop tard pour pouvoir le faire avec impunité ; ils furent vite découverts et appréhendés, et nous apprîmes le lendemain matin que plusieurs de ces misérables, qui avaient été pris sur le fait furent pendus.» (Dr Rigby's Letters, p. 55 à 57). Quand on a lu ces passages, on ne peut nier qu'il y ait du vrai dans le témoignage de Morellet, d'après lequel «dans la nuit du 13 au 14 des excès furent commis contre les personnes et les propriétés.»
> wikisource
![]() Tout semblait fini. Une scène non moins grande commençait. Après les privilèges des classes, vinrent ceux des provinces. Celles qu’on appelait Pays d’État, qui avaient des privilèges à elles, des avantages divers pour les libertés, pour l’impôt, rougirent de leur égoïsme, elles voulurent être France, quoi qu’il pût en coûter à leur intérêt personnel, à leurs vieux et bons souvenirs. Le Dauphiné, dès 1788 (cf Vizille après la journée des Tuiles), l’avait offert magnanimement pour lui-même et conseillé aux autres provinces. Il renouvela cette offre. Les plus obstinés, les Bretons, quoique liés par leurs mandats, liés par les anciens traités de leur province avec la France, n’en manifestèrent pas moins le désir de se réunir. La Provence en dit autant, puis la Bourgogne et la Bresse, la Normandie, le Poitou, l’Auvergne, l’Artois. La Lorraine, en termes touchants, dit qu’elle ne regretterait pas la domination de ses souverains adorés qui furent pères du peuple, si elle avait le bonheur de se réunir à ses frères, d’entrer avec eux dans cette maison maternelle de la France, dans cette immense et glorieuse famille ! Puis ce fut le tour des villes. »
Tout semblait fini. Une scène non moins grande commençait. Après les privilèges des classes, vinrent ceux des provinces. Celles qu’on appelait Pays d’État, qui avaient des privilèges à elles, des avantages divers pour les libertés, pour l’impôt, rougirent de leur égoïsme, elles voulurent être France, quoi qu’il pût en coûter à leur intérêt personnel, à leurs vieux et bons souvenirs. Le Dauphiné, dès 1788 (cf Vizille après la journée des Tuiles), l’avait offert magnanimement pour lui-même et conseillé aux autres provinces. Il renouvela cette offre. Les plus obstinés, les Bretons, quoique liés par leurs mandats, liés par les anciens traités de leur province avec la France, n’en manifestèrent pas moins le désir de se réunir. La Provence en dit autant, puis la Bourgogne et la Bresse, la Normandie, le Poitou, l’Auvergne, l’Artois. La Lorraine, en termes touchants, dit qu’elle ne regretterait pas la domination de ses souverains adorés qui furent pères du peuple, si elle avait le bonheur de se réunir à ses frères, d’entrer avec eux dans cette maison maternelle de la France, dans cette immense et glorieuse famille ! Puis ce fut le tour des villes. »![]() M. Le Guen de Kerengal, député de la Basse Bretagne :
M. Le Guen de Kerengal, député de la Basse Bretagne :