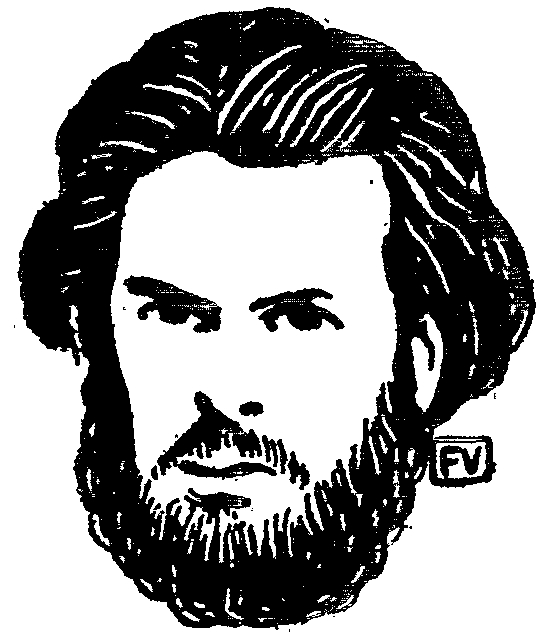Commune de Paris
La répression versaillaise
L'ordre régnait à Paris.
Cavaignac avait promis le pardon, et il massacra.
M. Thiers avait promis le massacre, il en saoula l'armée.
Il n'y eut plus à Paris qu'un gouvernement, l'armée qui avait massacré Paris.
« Soldats et marins, dit Mac-Mahon, le public applaudit au succès de vos patriotiques efforts.»
Lissagaray

Les Communards faits prisonniers durant la Semaine sanglante de mai 1871 étaient sommairement jugés par des cours martiales. Après les interrogatoires qui duraient en moyenne un quart d'heure, les condamnés étaient expédiés par groupe de 50 et de 100 devant les pelotons d'exécution. A Ivry, 800 d'entre eux furent exécutés à la mitrailleuse. Ceux qui avaient échappé à la mort étaient conduits à la Conciergerie de Versailles et dans le camp militaire de Satory où ils étaient parqués dans des conditions atroces, couchant dehors à même le sol, vivant dans la boue et les excréments : la morbidité y fut évidemment très élevée.
Les survivants furent ensuite dirigés en wagons à bestiaux vers les ports de mer où, enfermés plusieurs mois sur de vieux navires, ils attendirent le moment de leur déportation.
A partir de juillet 1871, c'est donc plus de 40 000 communards qui furent raflés par les troupes de Mac-Mahon et détenus dans différents lieux à Versailles.

Camp de Satory, 1871 -Pétroleuses emprisonnées et femmes chantantes, 1873, gravure .Ce sont ici les femmes du camp de Satory attendant la déportation. La seconde personne, bras croisés, à l'extrême droite, est Louise Michel. (Institut international d'histoire sociale)
Dans ses Mémoires, la communarde Louise Michel raconte :
 On ne peut rien voir de plus horrible que les nuits de Satory. On pouvait entrevoir par une fenêtre à laquelle il était défendu de regarder, sous peine de mort, (mais ce n'était pas la peine de se gêner) des choses comme on n'en vit jamais.
On ne peut rien voir de plus horrible que les nuits de Satory. On pouvait entrevoir par une fenêtre à laquelle il était défendu de regarder, sous peine de mort, (mais ce n'était pas la peine de se gêner) des choses comme on n'en vit jamais.
Sous la pluie intense, où de temps à autre à la lueur d'une lanterne qu'on élevait, les corps couchés dans la boue, apparaissaient sous forme de sillons ou de flots immobiles s'il se produisait un mouvement dans l'épouvantable étendue sur laquelle ruisselait l'eau. On entendait le petit bruit sec des fusils, on voyait des lueurs et les balles s'égrenaient dans le tas, tuaient au hasard.
D'autrefois, on appelait des noms, des hommes se levaient et suivaient une lanterne qu'on portait en avant, les prisonniers portant sur l'épaule la pelle et la pioche pour faire leurs fosses, qu'ils creusaient eux-mêmes, puis suivaient des soldats, le peloton d'exécution.
le cortège funèbre passait, on entendait des détonations, c'était fini pour cette nuit-là."
Lissagaray, témoin et acteur de la Commune, dans Les Huit journées de mai derrière les barricades, donne de longues descriptions du camp et des conditions faites aux prisonniers :
 Le Figaro décrivait ainsi la queue d'un convoi :
Le Figaro décrivait ainsi la queue d'un convoi :
« Le hideux troupeau est suivi de charrettes. La première attire surtout l'attention de la foule.
« Presque couché sur la première banquette enfoui dans la paille jusqu'aux genoux, mais, redressant le torse et la tête, on distingue un homme jeune encore, brun, et rappelant par son attitude le personnage principal des Moissonneurs, de Léopold Robert. Son visage annonce une rare énergie, il regarde la foule avec mépris, lui crie : Lâche ! lâche ! en lui lançant un crachat au détour de l'avenue.
« A ses pieds est couché un homme qui agonise : sa main soubresaute fébrilement, ses jambes s'agitent comme celles d'un homme atteint de la danse de Saint-Guy ; il râle ; il va mourir dans un instant.
« Sur une autre voiture est étendu un prisonnier qui a voulu s'échapper ; il porte au cou une large plaie béante ; sa tête chauve balance sur sa poitrine, comme si elle était à demi détachée du tronc. C'est horrible à voir.
« Une cantinière, assise sur la première banquette, insulte à la foule en la menaçant du poing ; ce poing est ensanglanté et a perdu plusieurs doigts dans la lutte de la barricade : un rouge coup de sabre lui traverse la figure.
« Un dernier peloton de chasseurs ferme la marche, et le hideux cortège va rejoindre le premier.
« On entend un bruit de tambours lointain : une poussière blanche s'élève à l'horizon : c'est un nouveau convoi de prisonniers qu'on nous amène. »
Les honnêtes gens de Versailles couraient comme à une fête au devant de ces chaînes sans fin. Et les dames du meilleur monde ne dédaignaient pas de donner du bout de leurs ombrelles dans le flanc de quelques fédérés. Escortés par les risées et les imprécations de cette populace gantée, ces malheureux traversaient dans toute son étendue la ville de Versailles, toujours tête nue au soleil, et gravissaient la hauteur de Satory. Le correspondant d'un journal clérical belge, disait avoir vu dans le même chariot à fumier un mort, un mourant, un blessé, et la foule criait : « En voilà qui ne donneront pas d'embarras à leur confesseur. » Il ajoutait : « Un avocat distingué, qui n'a pas son pareil pour maudire la Commune, dit qu'il a vu avec dégoût un officier tirer son sabre contre une femme qui tâchait de sortir des rangs, lui faire une large blessure au visage et lui enlever du même coup une portion de l'épaule. »
« En voyant comme volaient les injures, les ricanements, etc. » disait l'Indépendance Belge, « je ne pouvais m'empêcher de penser que si quelqu'un s'en fût permis autant, quand, il y a quatre mois, passaient dans une de nos villes des prisonniers prussiens, il n'y aurait eu qu'un cri de réprobation dans la foule. Quoiqu'il en soit, ce spectacle fait mal. Aux portes de la ville, on force les prisonniers à se découvrir : « Allons ! Canaille ! chapeaux bas devant les honnêtes gens ! » Quelques-uns résistent : alors le bout d'une canne fait tomber à terre leur képi.»
Malheur à qui laissait échapper une parole de commisération. Sur la place d'Armes, deux rédacteurs des journaux les plus enragés de Versailles, écœurés à la fin de tant d'ignominies, voulurent élever la voix, faire respecter les vaincus. Immédiatement entourés, bousculés, maltraités, on les saisit et ce fut à grand-peine qu'ils purent être conduits au poste sans être mis en lambeaux. A Paris, beaucoup de personnes qui avaient manifesté sur le passage des prisonniers des sentiments de commisération, furent arrêtées et souvent jointes aux convois. L'arrestation de Rochefort n'avait pas été moins odieuse. « De tous côtés, disait le Français, on entendait les cris : « A mort ! à mort ! » Près de la porte de la prison, un spectateur ayant crié : « A la lanterne !» ce cri fut immédiatement répété par toute la foule! »
Et voilà ces civilisés de Versailles qui devaient faire rentrer la France dans la voie de la civilisation ! Combien, malgré les souffrances affreuses de deux mois de siège, ces brigands de Paris furent bons et humains à côté de ces honnêtes gens ! Quand a-t-on insulté un prisonnier dans le Paris de la Commune? Quand peut-on citer une seule scène semblable aux sauvageries qui journellement se produisaient à Versailles ?
Quel coin obscur de la Conciergerie a caché la millième partie des tortures qui s'étalaient en plein soleil au camp de Satory ?
« Ils sont là, disait l'Indépendance française, plusieurs milliers, empoisonnés de crasse et de vermine, infectant à un kilomètre à la ronde. Des canons sont braqués sur ces misérables, parqués comme des bêtes fauves. Les habitants de Paris craignent l'épidémie résultant de l'enfouissement des insurgés tués dans la ville ; ceux que l'Officiel de Paris appelait les ruraux craignent bien davantage l'épidémie résultant de la présence des insurgés vivants au camp de Satory. »
On les avait jetés là, en plein air, tête découverte ; ils couchaient dans la boue, n'ayant d'autre nourriture que du biscuit gâté et de l'eau infecte puisée à une mare dans laquelle les gardiens ne se gênaient pas pour faire leurs ordures. Les premières nuits furent très-froides, il plut beaucoup. Dans celle du vendredi 26, dix-sept d'entre eux moururent.
Le grand mur d'enceinte du camp était crénelé. Par des trous de distance en distance passait la bouche des mitrailleuses, qu'on avait eu soin auparavant de faire défiler devant les prisonniers. Des deux côtés de la porte centrale, des chasseurs à cheval faisaient la haie, le sabre au poing. - Il arriva que les soldats, pris de panique ou de rage, déchargèrent leurs chassepots dans le tas. Dans la nuit du 25 au 26 mai, il y eut une sorte d'émeute, ou du moins les gardiens l'affirmèrent. Trois cents prisonniers furent passés par les armes. Amenés au bord d'une fosse garnie de paille ils y furent précipités à coups de fusil, puis on arrosa le tout de pétrole et on mit le feu. Beaucoup n'étaient pas morts. Il y eut des hurlements épouvantables. A de certaines heures, ordre était donné à tous de se lever, de se coucher sur le côté gauche ou sur le côté droit, et toute infraction à ce commandement était suivie de coups de revolver.
Les journaux ne tarissaient pas sur la mine ignoble des prisonniers. « Ces êtres sont hideux », disait Paris-Journal. « Toutes ces faces sont hargneuses, bilieuses, renfrognées » (Figaro). « Visages patibulaires » (la France). « Chienlits Maquillés de sang et de poudre, qui volaient à jeun et tuaient après dîner », disait un autre.
Ces messieurs trouvaient étonnant que des gens qu'on couche dans la boue et en plein air, dont on fusille de temps en temps quelques centaines, n'eussent pas la mine fleurie d'un rédacteur versaillais. Et flétrir la mauvaise et triste mine voilà tout ce que cet odieux spectacle leur inspirait.
Lissagaray. p 206 et suivantes
 Le camp de Satory devint, comme la route de Versailles, le but de promenade de la bonne compagnie. Les officiers en faisaient les honneurs aux dames, aux députés, aux fonctionnaires, leur montraient les sujets, au besoin les prêtaient à M. Dumas fils, pour qu'il pût commencer in anima vili ses études sur la question sociale.
Le camp de Satory devint, comme la route de Versailles, le but de promenade de la bonne compagnie. Les officiers en faisaient les honneurs aux dames, aux députés, aux fonctionnaires, leur montraient les sujets, au besoin les prêtaient à M. Dumas fils, pour qu'il pût commencer in anima vili ses études sur la question sociale.
En général, les prisonniers, avant d'être envoyés à Satory, séjournaient quelque temps dans l'Orangerie de Versailles, entassés dans ces immenses serres, pêle-mêle, sans paille dans les premiers jours. Quand ils en eurent, elle fut bien vite réduite en fumier, on ne la renouvela plus. — Pas d'eau pour se laver, nul linge, nul moyen de changer ses guenilles. Deux fois par jour, dans une auge, un liquide jaunâtre, — c'était la pâtée. — Pas de médecins. Il y avait des blessés, la gangrène les rongea ; des ophtalmies se déclarèrent. —Les cas de folie furent nombreux. — Derrière les grilles s'entassaient les femmes ; les filles des prisonniers, hébétées, affolées, s'efforçant de distinguer un être cher dans ce troupeau vaguement entrevu dans l'ombre, derrière les caisses d'orangers rangées en palissade.
Ces malheureuses s'arrachaient les cheveux de désespoir, grondaient sourdement contre les soldats qui, le chassepot chargé, regardaient menaçants.
De temps en temps, une sorte de magistrat instructeur arrivait, faisait appeler les détenus, qui étaient conduits devant lui par escouades de dix, les menottes aux mains, et accompagnés tantôt par des sergents de ville, tantôt par un peloton de soldats. — Instruction dérisoire! Comment d'ailleurs, par quel témoignage arriver à constituer le dossier de quarante mille prisonniers ? — On n'y songeait même pas.
Bientôt le camp, quoique immense, fut encombré et l'on dut évacuer les victimes. Dès le 26, on les dirigea sur les ports de mer. On les enfermait dans des wagons à bétail solidement cadenassés, sans autres ouvertures que quelques trous à air, et. ils y restaient souvent trente-deux heures. Entre les différents wagons on en intercalait un, compose de sergents de ville, munis de chassepots et de revolvers.
A la Ferté-Bernard, le train avait dépassé la gare de 200 mètres, quand des cris partirent de plusieurs wagons ; les prisonniers étouffaient. Le chef de l'escorte fit arrêter le convoi, les agents descendirent et déchargèrent leurs revolvers à travers les trous à air. Le silence se fit... et les cercueils roulants repartirent à toute vapeur.
A Brest et à Cherbourg, les prisonniers furent répartis sur de vieux vaisseaux embossés en rade, chacun de ces bâtiments contenant environ mille prisonniers. Depuis la cale jusqu'au pont, dit un témoin oculaire, ils sont — (ils sont encore après quatre mois !) — empilés dans des parcs formés par des madriers comme dans de grandes caisses d'emballage. Les sabords cloués ne laissent passer qu'un filet de lumière. Nulle ventilation. L'infection est horrible. La vermine y grouille. Il y a des blessés : pas de médicaments, pas d'ambulances ; rien.
Les malheureux, inconnus, — car on n'a pas la liste de leurs noms, on ne s'est pas occupé de leur identité,— restent là, entassés dans leurs cages, gardés par des canons chargés à mitraille, enfermés entre d'énormes grilles de fer, plus misérables que les nègres à bord d'un navire faisant la traite. »
Tout matelot que l'on surprend causant avec eux est passible de mort. Les sentinelles qui veillent aux entreponts ont ordre de tirer sur les détenus s'ils s'approchaient du grillage des sabords. Leur nourriture est ainsi composée : à cinq heures du matin, un biscuit ; à midi, du pain et des haricots ; à six heures, un biscuit et des haricots. Pas de vin, pas de tabac. Les envois ne parviennent point."
Lissagaray, Les Huit journées de mai derrière les barricades, p.212 et suivantes
![]() La liberté a repris ses chaînes ; la pensée ses menottes ; encore une fois, grâce à la peur, tout est permis à ceux qui règnent. La ville qui était la capitale du monde, et qui n’est plus même la capitale de la France, a perdu ses citoyens ; mais elle a retrouvé ses petits crevés et ses courtisanes. Tout ce qu’elle avait de sang généreux a coulé dans ses ruisseaux et a rougi – ce n’est pas une figure – les eaux de la Seine ; et pendant huit jours et huit nuits, afin que le Paris de la révolution redevint le Paris des empires, on en a fait un immense abattoir humain !
La liberté a repris ses chaînes ; la pensée ses menottes ; encore une fois, grâce à la peur, tout est permis à ceux qui règnent. La ville qui était la capitale du monde, et qui n’est plus même la capitale de la France, a perdu ses citoyens ; mais elle a retrouvé ses petits crevés et ses courtisanes. Tout ce qu’elle avait de sang généreux a coulé dans ses ruisseaux et a rougi – ce n’est pas une figure – les eaux de la Seine ; et pendant huit jours et huit nuits, afin que le Paris de la révolution redevint le Paris des empires, on en a fait un immense abattoir humain !![]() La France, abandonnée à l’étranger ; les trahisons et les malversations de 1870 ; l’armistice et la paix de 1871 , la guerre civile, l’égorgement de Paris, la terreur tricolore, l’instruction publique aux prêtres, la presse aux financiers, la justice aux entremetteurs, l’armée aux assassins, l’administration aux corrompus, la politique aux Basiles, que peut faire de mieux une monarchie ? "
La France, abandonnée à l’étranger ; les trahisons et les malversations de 1870 ; l’armistice et la paix de 1871 , la guerre civile, l’égorgement de Paris, la terreur tricolore, l’instruction publique aux prêtres, la presse aux financiers, la justice aux entremetteurs, l’armée aux assassins, l’administration aux corrompus, la politique aux Basiles, que peut faire de mieux une monarchie ? "